Les phoques fossiles: l’Eldorado du Pérou, Leonard Dewaele
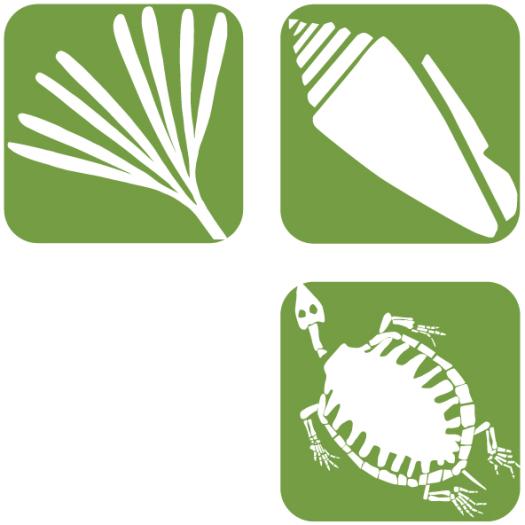
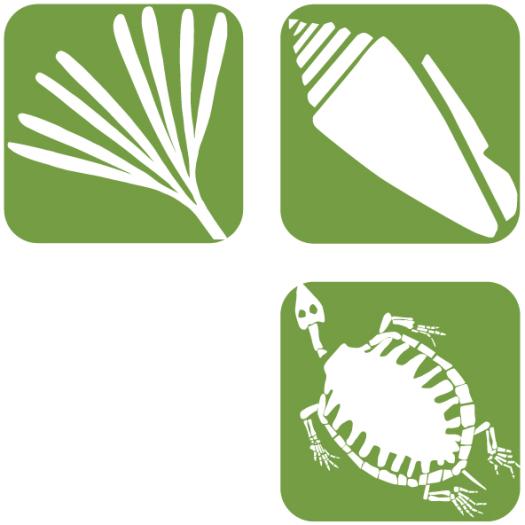
Le prochain séminaire du CR2P aura lieu le juedi 16 janvier à 13h à l’amphithéatre d’Anatomie comparée et de Paléontologie.
Historiquement, la recherche paléontologique sur les phoques (Pinnipedia, Phocidae) s’est focalisée sur les régions les plus explorées de l’époque: les couches du Miocène d’Europe et de la côte est des E-U. Plus tard, d’autres régions (e.g., l’Afrique du Sud, et Chile et Pérou) ont produit une grande quantité de spécimens fossiles de phoques. Tandis que les spécimens de phoques fossiles provenant de sites de l’hémisphère nord consistent en des ossements isolés et fragmentés, les squelettes de phoques fossiles découverts au Pérou à partir de la fin des années 70 sont souvent beaucoup plus complet. Combinées avec un contexte stratigraphique de mieux en mieux connu, la qualité de préservation et la diversité des phoques fossiles du Pérou telles que révélées au cours des années ont donné à ce matériel le statut des fossiles-clés pour étudier l’histoire évolutive des phocidés. Au-delà des études systématiques et phylogénétiques, une pléthore de techniques nouvelles d’analyse peuvent être appliquées à ces ossements; micro-anatomie interne à l’aide de données de CT scans, résistance des os par analyse des éléments finis (FEA), et morphométrie vont permettre de mieux comprendre certaines phases clé de l’évolution du groupe, et en particulier leur colonisation de l’hémisphère sud et leurs adaptations aux conditions extrêmes de l’océan Austral.



